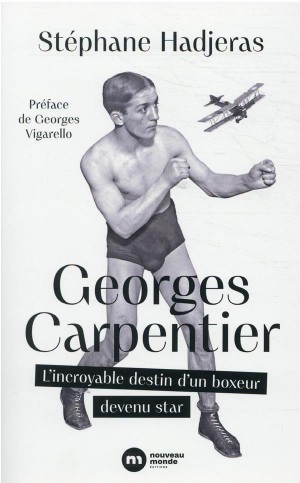Historien à l’université de Limoges, Loïc Artiaga est également le biographe de notre personnage de fiction préféré : Robert « Rocky » Balboa. Ça valait bien une discussion entre connaisseurs.
CultureBoxe : J’ai du mal à imaginer qu’on puisse écrire une biographie de Rocky sans avoir eu un coup de cœur pour lui à un moment ou un autre, sans avoir expérimenté son côté inspirant, touchant. C’est le héros de notre génération. Et pourtant tu ne le ménages pas ! Quelle est ta relation avec Rocky ?
Loïc Artiaga : Je pense que tu as raison quand tu parles de génération. C’est un truc dont j’ai pu me rendre compte dans des rencontres avec des lecteurs ou en discutant avec les étudiants. En fait, c’est assez fou comme les mecs qui ont entre 40 et 50 ans ont grandi avec Stallone. Nicolas Mathieu en parle souvent. Évidemment, j’aime Rocky. Je l’ai vu au cinéma, j’ai grandi avec ses posters dans ma chambre. C’était un peu douloureux d’aller contre…
Ah ! Ça me rassure parce que parfois je me disais : « Quand même ! Il est fou ! Comment est-ce qu’il peut faire ça ? » Et en même temps, j’étais d’accord avec toutes tes conclusions…
Rocky peut encaisser. C’est sa qualité première. Il peut même encaisser la critique scientifique. D’ailleurs notre génération aussi peut entendre cette critique. Je sens vraiment des fractures générationnelles quand j’en parle avec mes étudiants. Souvent, ils n’ont pas connu Rocky. Parfois, ils confondent, ils croient que c’est un mec qui a vraiment existé. Et quand on commence à analyser, ils ont tendance à vite zapper. Si c’est problématique, on ne va pas le regarder. Les gens de notre génération trouvent ça un peu dur, mais salutaire. Un peu comme quand on entend des remises en question des filles sur les rapports de genre, sur comment on se comporte comme des mecs de 40 ans… À la fin, on se dit qu’elles ont raison.
Donc, il encaisse bien !
Oui, il n’est pas démoli à la fin. Ce n’est pas mon petit livre qui va le mettre au tapis. Même si j’ai donné l’image d’un Rocky plus sombre.
Quitte à laisser un peu de côté la dimension touchante du personnage ?
Son côté touchant, c’est ce qu’on ressasse tous. Il n’y a pas longtemps, j’ai relu Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu. Il y a une citation de Rocky IV. On sent bien la sympathie qu’il a pour le personnage C’est un truc qu’il dit souvent l’interview par ailleurs.
En revanche, tu nous présentes Rocky comme le premier champion de la crise. Avec Rocky j’ai l’impression qu’on est toujours au croisement de deux forces : il apporte du réconfort à beaucoup de gens dans des périodes de crise, quand il faut tenir le choc… Il y a cette idée que tu peux être acteur de ta vie mais, en même temps, dans le monde de Rocky, il n’y a pas d’excuses, il n’y a rien pour t’aider. T’es tout seul. Et si tu rates, tu deviens d’être un loser, non ? Comment est-ce que tu navigues entre ces deux tensions, entre l’espoir d’un côté et la cruauté ou le darwinisme de l’autre ?
À vrai dire, je ne me souvenais pas de la cruauté du monde de Rocky. Je m’en suis aperçu en faisant des visionnages assez intensifs, avec beaucoup d’arrêts sur image, pour essayer d’échapper à la narration et explorer l’arrière-plan. En posant de manière concrète les relations sociales qu’il a avec son entourage, je me suis rendu compte que les relations sociales sont hyper trash. Les coups qu’il prend dans la vie de tous les jours semblent finalement presque plus rudes que sur le ring. Ou alors le match est aussi une métaphore de tout ça. On essaie sans arrêt de profiter de lui.
Ce qui me plaît dans Rocky, c’est qu’il y a toujours des forces qui se croisent, parfois contradictoires, parfois juste surprenantes. Par exemple, le côté héros américain et universel. C’est peut-être le dernier gars à croire ou à incarner le rêve américain dans une période ultra compliquée où les gens en prennent plein la gueule. Et en même temps, c’est un héros universel qui touche tout le monde, même les Soviétiques qui font circuler ses cassettes sous le manteau. Comment est-ce qu’il arrive à être à la fois américain et universel ? Qu’est-ce qui nous touche, nous Français, chez ce mec ?
Il nous touche dans une période particulière. La mondialisation de Rocky, quand les films ont vraiment du succès en Europe, c’est le milieu des années 80. Ça va avec une américanisation beaucoup plus large. On a grandi dans un univers qui, d’un point de vue culturel, était ultra américanisé : les joueurs de basket U.S, le fast food, Rocky…
Il y a plusieurs niveaux de lecture qui se superposent et c’est sans doute ce qui explique qu’on ait pas voulu voir la question de la race. Dans les années 80-90 en France, il y a « Touche pas à mon pote ». On est une génération très marquée par l’antiracisme, mais on n’a pas une lecture systématique comme aujourd’hui où on pose la question de la race comme une question à l’intersection d’autres luttes.
Je ne sais pas trop ce que les Klitschko avaient en tête quand ils regardaient Rocky. Mais j’ai été très surpris que beaucoup de boxeurs voient encore Rocky comme un modèle. OK, ils disent tous qu’il ne boxe pas comme on doit boxer mais ça reste une figure modèle parce que la motivation, parce qu’il évolue dans un monde où tu ne peux compter sur personne si ce n’est sur toi même. Et ça, ça devient une valeur universelle dans les années 80. L’américanisation, c’est aussi une américanisation des valeurs. Je pense qu’il incarne ça de manière puissante et un peu désarmante. C’est la meilleure arme du soft power US. Il est hyper sympa, en fait.
Tu ne crois pas que nous, en Europe, on l’a surtout reçu avec nos propres grilles de lecture comme, par exemple, la « common decency » de George Orwell, le côté « working class hero » ?
Oui, sans doute, mais c’est un patchwork de tout ça qui fait qu’il est aussi populaire. On est traversé de plein de contradictions quand on est attaché à des figures médiatiques comme celle-là. Pour que ça tienne et que ça suscite des discussions encore aujourd’hui – moi, ça m’a occupé deux ans à écrire un bouquin- c’est bien qu’au-delà de l’écran, il y a des ressorts assez puissants qui viennent nous toucher.
En parlant de ressorts un peu souterrains, Rocky est le premier blanc champion du monde des lourds depuis Marciano. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce besoin de remettre l’église au milieu du village, de remettre de l’ordre dans l’histoire de la boxe ?
C’est la théorie du Great White Hope. Le grand espoir blanc. Pour comprendre ça, il faut remonter au XIXᵉsiècle et à la construction d’un système sportif occidentalo-centré. À l’époque, un champion de boxe, c’est un corps blanc qui performe. Et parmi les titres qui sont les plus symboliques, il y a celui d’homme le plus fort du monde c’est-à-dire le titre de champion des lourds. Or, tout cela se heurte à une réalité athlétique qui est plus complexe avec, notamment, les aspirations des non-Blancs à participer au festin.
Il y a des figures de boxeurs noirs qui émergent dans des championnats séparés. Ils combattent pour le titre de champion du monde des Noirs. Et puis évidemment, il y a l’irruption de Jack Johnson, dont l’image du succès et les images filmées du succès vont provoquer des émeutes aux États-Unis, au point qu’on interdit la diffusion des matchs montrant Johnson victorieux.
Mon hypothèse c’est que c’est précisément à ce moment-là qu’on commence à imaginer des boxeurs blancs. Il y a des vrais boxeurs qu’on va faire monter sur le ring pour récupérer le titre, mais aussi une foultitude d’espoirs blancs qui se produisent sur grand écran. Si ça ne marche pas sur le ring, ça marchera ailleurs. Rocky est la figure la plus aboutie, mais c’est une histoire longue. Ça commence dès l’entre-deux guerres, avec toute une floppée de films qui développent des histoires assez similaires. Il y a cette volonté de voir advenir un champion blanc et toute la subtilité de Rocky, c’est de choisir un italo-américain.
Un Blanc mais un Blanc outsider ?
C’est assez malin, d’autant que, dans les années 70, les Italiens sont en train de gagner une respectabilité tout à fait nouvelle dans la société américaine. Avec le cinéma mais pas que. C’est un moment d’embourgeoisement pour les Italo-américains.
J’en profite pour revenir à la filiation entre Rocky Marciano et Rocky Balboa. Marciano a embrassé l’american way of life au contraire d’Ali qui s’est battu contre les valeurs dominantes. Est-ce que Rocky restaure ce lien perdu entre le champion et le pays ?
C’est mon hypothèse. Sans Ali, il n’y a pas de Rocky. C’est la réponse médiatique à Ali. Il y aussi le match entre Ali et Marciano, le Super Computer Fight, avec Ali qui se fait rouler dans la farine. En fait, l’Amérique attend un mec qui va lui fermer sa grande bouche et le mettre par terre.
Apollo Creed serait une espèce de caricature sans substance de Mohamed Ali.
Oui, c’est un Ali un peu fade, qui en a tous les tics médiatiques, sans la substance politique. Un Ali qui manipule l’héritage national. Quand Rocky I sort, en 1976, le personnage de Creed peut poser problème à une Amérique conservatrice. Si tu es un peu réactionnaire, ses discours, sa façon d’instrumentaliser Philadelphie, le bicentenaire…C’est vraiment le salopard qui joue avec ce avec quoi il ne faut pas jouer.
Le succès de Rocky s’expliquerait en partie parce qu’il surfe sur des frustrations qui agissent un peu en sous-main… Est-ce que tu penses que Stallone en est conscient ?
C’est hyper dur de répondre parce qu’on n’est pas dans sa tête. Et cette lecture occulte le contexte de réception qui est toujours beaucoup plus puissant que l’ambition du créateur. Cela dit, je suis persuadé que les artistes, les créateurs, les cinéastes, les romanciers sont des sociologues qui font advenir des lectures du monde.
Ils voient, ils font voir quelque chose qu’ils ne pensent pas.
Oui, ils le font voir et il y a besoin d’une analyse derrière. D’où notre conversation et les milliers de commentaires sur le film. Ils nous donnent quelque chose à voir et à analyser qui n’est sans doute pas aussi abouti que la lecture d’un sociologue. Mais contrairement à un bouquin de sociologie sur l’Amérique des années 70, on regarde encore Rocky aujourd’hui.
Il fait advenir un truc. Et à c’est à nous d’en tirer des conclusions. Son génie, il est là. Ce qui est très fort, c’est que le film est fait avec trois bouts de ficelles. Dans son dernier post sur Instagram, Stallone a récupéré aux enchères la robe rouge avec le petit col doré. Il raconte qu’ils n’avaient pas de sous, que la robe était trop grande pour lui, qu’il se sentait un peu ridicule. Tout a été bricolé.
Ça me fait penser à la scène de la patinoire qui a lieu parce qu’ils n’ont pas d’argent pour louer un café ou à la musique qu’ils étirent en boucle pour les séquences d’entraînement…
C’est vrai que c’est fou de se dire que la scène de la patinoire est un accident. Je peux la voir 1 000 fois et à chaque fois ça me met les poils.
Moi, ce qui me touche, c’est surtout quand la boxe passe au second plan. Rocky I, c’est un film d’amour, en fait. Il n’y a presque pas de boxe dans Rocky VI. On se demande juste comment tu fais pour avancer quand tu as perdu ce que tu aimais le plus, Adrien… Et là, tu retrouves le côté un peu sado-maso de Rocky. Tout le monde lui dit : « T’es trop vieux, tu vas prendre des coups » alors que, pour lui, la douleur du ring est presque une consolation par rapport à la douleur de vivre. Il s’en fiche de prendre des coups.
Puisque de toute façon rien ne frappe plus fort que la vie.
Amen. Attention, je vais te poser une question un peu improbable : ces dernières années, j’ai remarqué qu’il y avait en France de plus en plus de livres ou séries mettant en scène des présidents noirs ou arabes (Les sauvages, Craignos, Soumission de Houellebecq…). Est-ce que ça peut relever du même phénomène de frustration – celle des Blancs aux Etats-Unis – que tu décris dans ton livre ? Comme si les désirs d’une partie de la société ne pouvaient s’exprimer qu’à travers la fiction…
Je ne sais pas mais en tout cas on peut avoir une lecture longue du phénomène. C’est quelque chose qui apparaît dans les pays anglo-saxons dans les années 1860-70, puis assez vite en France. Les industries culturelles font advenir des figures qui n’existent pas et leur donnent suffisamment de consistance et de force motrice pour que s’enclenchent des phénomènes nouveaux dans la société. Des gens décident qu’ils ont envie de croire à l’existence de Sherlock Holmes, de tel ou tel personnage de fiction tout en sachant que ces personnages n’existent pas dans la réalité. Aujourd’hui, on vit avec des figures qui ont été forgées par les industries culturelles. C’est une rupture anthropologique. On connaît mieux Rocky, qui est un personnage de fiction, que la plupart des boxeurs du XXᵉ siècle. De la même manière, beaucoup de gens connaissent mieux la géographie du monde d’Harry Potter que celle du Rwanda. Le problème c’est que ça sert aussi à invisibiliser une partie du monde. Ces industries culturelles ont leur défaut de fabrication : elles proviennent de nos mondes à nous, mais elles ne permettent pas vraiment de saisir le monde dans toute sa complexité et sa globalité.
Dernière question sur un boxeur, un vrai. T’as rencontré Larry Holmes ?
C’est Gerry Cooney qui m’a donné son numéro de téléphone. Je lui envoie un message. Dix minutes plus tard, je vois mon téléphone qui sonne avec un numéro états-unien. Je décroche, c’était un appel Face Time : Larry Holmes ! « Attendez, faut que j’enregistre ce qu’on va se dire. » C’était un moment complètement fou ! Et lui, pour le coup, il a bien conscience d’avoir été invisibilisé par Rocky.
C’est un peu la victime collatérale…
On lui a volé la lumière. Les dates de sa domination sur les lourds correspondent, à quelques mois près, aux dates de Rocky.
Loïc Artiaga, Rocky : la revanche rêvée des Blancs, Les Prairies ordinaires.