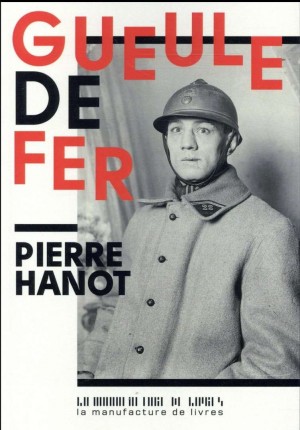Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion d’interroger Souleymane Cissokho pour l’ouvrage ci-dessus, Les grands managers du sport se confient. Ce solide pavé, publié aux éditions Amphora sous la direction de Philippe Rodier, réunit les témoignages d’un certain nombre de managers sportifs qui comptent, dont John Dovi qui est aux manettes de l’équipe de France de boxe olympique et qui m’a lui aussi fait l’honneur d’une entrevue. Cela dit, les auteurs ont voulu laisser une place aux témoignages de sportifs comme Souleymane qui a partagé avec moi son rapport à la boxe en mettant l’accent sur la préparation physique et mentale nécessaire pour relever le défi d’un défi d’un sport qui, comme on le sait, est toujours un peu plus qu’un sport. Merci à lui pour le temps qu’il m’a consacré. Merci également à Philippe Rodier pour sa confiance et pour me permettre de publier l’intégralité de l’entretien sur CultureBoxe. Bonne lecture et n’hésitez pas à acheter le bouquin chez votre libraire ou ailleurs !
—
Pour cette nouvelle escale, nous allons prendre la direction du ring pour un instant particulier aux côtés d’un médaillé olympique. Après avoir obtenu le bronze à Rio, lors des derniers Jeux Olympiques, Souleymane Cissokho, le capitaine de la Team Solide, a fait des débuts tonitruants dans les rangs professionnels : onze victoires – dont sept par KO – en autant de combats avant que le confinement ne le contraigne à ralentir un peu la cadence. Une performance de taille dans un sport aussi rigoureux physiquement que mentalement et où la pression ne fait que grandir au fil du temps. Entre la France, où il boxe régulièrement, et les États-Unis, où il s’entraîne sous la houlette de Virgil Hunter, l’un des plus grands coachs de boxe de la planète, ce jeune homme pressé a déjà le titre de champion du monde des super-welters dans le viseur. Sa méthode ? S’entourer des meilleurs et tout donner à l’entraînement. Avec un seul mot d’ordre, aussi simple qu’un direct bien senti : zéro regret.
– Souleymane Cissokho : quand on dresse la liste des différents entraîneurs que vous avez côtoyés durant votre carrière (José Chacon, Ali Oubaali, John Dovi, Luis Mariano Gonzalez, Virgil Hunter), on constate que vous avez connu beaucoup d’entraîneurs avec des profils différents. Qu’avez-vous tiré de chaque expérience à leur côté ?
J’ai tiré beaucoup de choses de ces différents entraîneurs et ça continue parce que ce sont des personnes dont je suis resté proche au fil du temps. J’ai commencé la boxe éducative avec José Chacon et Ousmane, un autre coach du BAC 9 : on était un groupe d’amis et on voulait avant tout se faire plaisir. C’est Monsieur José qui m’a donné l’amour de la boxe. Le BAC 9, c’est l’une des meilleures ambiances de la capitale. Dans cette salle, tout le monde se respecte, tout le monde est sur un pied d’égalité, tout le monde s’encourage, et moi j’aime bien cette mentalité-là. C’est une famille. Et J’en ai tiré beaucoup de valeurs de cette famille. Ensuite, j’ai voulu évoluer vers le haut niveau, qu’on soit plus concentré sur moi, du coup je suis allé chez Ali Oubaali, qui est toujours mon coach en France. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup apporté, qui m’a donné confiance en moi et qui m’a permis d’être plus posé et plus relâché dans ma boxe. Avec son expérience de la boxe olympique, de la boxe professionnelle, des États-Unis, il m’a fait découvrir une autre philosophie et il a fait grandir ma boxe. C’est quelqu’un qui sait de quoi il parle. On a beaucoup travaillé et ça a payé. Avec les entraîneurs nationaux, John Dovi et Luis Mariano Gonzalez, on a travaillé en parallèle, de façon complémentaire. On a tissé des liens aussi. On a voyagé partout dans le monde. Pas plus tard qu’il y a une semaine, j’ai eu John au téléphone et, il y a quelques jours, Mariano par message. Ils ont chacun leur touche personnelle et je me nourris de cela. John, c’est la rigueur alors que Mariano aime bien qu’on boxe en s’amusant, le côté esthétique du sport. Avec John on travaille aussi le côté technique mais on met l’accent sur du travail à mi-distance, les blocages, les remises, etc. Ils sont complémentaires : Mariano est un grand spécialiste de la boxe à distance et à mi-distance, et John c’est la boxe au corps et à mi-distance. Travailler avec les deux m’a permis de progresser. Ensuite, quand je suis passé pro, j’ai voulu rejoindre Virgil Hunter aux États-Unis parce que c’est une référence. Ça faisait des années que je les suivais, André Ward et lui. Il a beaucoup d’expérience et j’apprends tous les jours avec lui, j’ai l’impression de redécouvrir la boxe. J’aime beaucoup sa philosophie : on revient aux bases de la boxe. L’objectif, c’est de toucher sans se faire touche. On travaille beaucoup le bras avant, le jab. C’est « scientifique », ça se joue au centimètre près. Et puis quand tu mets en pratique ce qu’il te dit, tu vois tout de suite que ça marche.
– Précédemment, John Dovi nous a confié avoir beaucoup appris de sa défaite en quarts de finale des Jeux de Sydney contre le futur médaillé d’or de cette compétition. De votre côté, vous avez boxé face à des cadors en amateurs, comme Vasyl Lomachenko. Avez-vous connu des défaites qui vous ont permis d’évoluer et de devenir un meilleur boxeur ?
Bien sûr. J’ai tiré beaucoup de leçons de la plupart de mes défaites sauf de celles qui relèvent de la décision des juges et des arbitres. Dans ces cas-là, il n’y a pas grand-chose à retenir. Ce sont des combats que tu n’as pas vraiment perdus mais cela fait très mal quand même. Attention, je ne suis pas un gars qui triche… Si je perds, je n’ai aucun problème pour le dire mais j’ai vécu beaucoup de décisions où je n’avais pas forcément perdu le combat. Lors de ma première année en senior j’ai perdu en demi-finale des championnats de France. C’est une défaite qui m’a fait grandir. Perdre en demi-finale en France, dans mon pays, cela m’a mis un coup et ça m’a fait évoluer. L’année d’après je suis devenu champion de France haut la main. Il y a aussi eu le combat contre Lomachenko, un grand champion. Je l’ai revu il n’y a pas longtemps et je fais vraiment un très beau combat où je lui pose des problèmes. C’est un combat qui m’a fait grandir, quelques semaines avant les championnats d’Europe, et qui m’a permis de faire de bons résultats par la suite.
– Vous avez tenu le rôle de capitaine de l’équipe de France olympique lors des Jeux de Rio. Qu’est-ce que cela veut dire pour vous « être capitaine » ?
J’ai toujours eu ce genre de leadership en moi. À chaque entraînement, je suis là pour encourager les gars, pour les motiver. Même chose pendant les combats où je donne de la voix et je suis derrière eux. C’est un rôle qui est venu comme ça. Je suppose que les coachs m’ont choisi parce que j’étais légitime. J’étais l’un des plus anciens, celui qui rassemblait tout le monde. C’est un rôle que j’ai pris à cœur. Et, cela m’a fait super plaisir d’être capitaine de cette équipe de France. On a fait de très bons résultats avec six médailles olympiques (deux d’or, deux d’argent et deux de bronze). On était un groupe exemplaire en termes de comportement et de message.
– On vous présente généralement comme quelqu’un de calme, posé et qui a la tête sur les épaules. Mais un capitaine est parfois amené à mettre les points sur les « i ». Avez-vous dû vous faire « violence » ? Et, avez-vous parfois eu la crainte que ce rôle puisse impacter vos objectifs personnels ?
Pas du tout. Dans ce groupe, tout le monde tirait dans la même direction. On était déterminés. On voulait ramener le maximum de médailles par rapport au vol des Jeux de 2012. On n’était pas là pour rigoler. On voulait faire les plus beaux combats. Et ça s’est ressenti sur le ring et autour, dans la voix qu’on mettait pour encourager le reste du groupe. Je n’ai pas eu à pousser de coups de gueule, on savait tous ce qu’on voulait.
– Est-ce que justement, à l’image d’un Steven Gerrard avec Liverpool ou d’un Francesco Totti avec l’AS Roma dans le milieu du football, vous avez l’impression que ce rôle peut vous « subjuguer » d’une certaine façon ? Dans le monde du football, certains entraîneurs décident parfois même de donner le capitanat à un joueur qui ne s’y attend pas pour lui faire prendre conscience de certaines « choses ».
Ce qui est sûr, c’est que ce rôle de conseil a toujours été naturel pour moi. D’ailleurs on continue à s’appeler avec pas mal de mecs de la Team Solide. Ils m’appellent toujours capitaine ! Ils voient que j’arrive à bien gérer mon image donc certains me demandent des conseils. Quand j’étais plus jeune, on m’a beaucoup donné et conseillé, donc c’est dans mon ADN de redonner et d’aider.
– Que se passe-t-il dans votre tête quand on arrête votre combat en demi-finale des Jeux sur coupure ? Comment avez-vous géré les jours qui ont suivi ? Vous avez des échanges particuliers avec votre entraîneur pour « dédramatiser » l’évènement ?
C’est vrai que ça a été très frustrant. Le parcours pour se qualifier aux Jeux avait été très dur. C’était la guerre. Je me suis blessé avant le premier tournoi de qualification et je n’ai pas pu le faire. Même chose une semaine avant le deuxième tournoi de qualification. Finalement, je fais le dernier tournoi de qualification et je me qualifie. Puis, deux semaines avant les Jeux, je me blesse à la main. Un vrai parcours du combattant. Mais je savais que si je me qualifiais, j’allais être récompensé par une médaille. Je l’avais dit aux mecs. Je le sentais au fond de moi. J’ai été frustré par l’issue du combat. Le mec m’avait déjà battu deux fois. Il était champion du monde et numéro 1 mondial donc j’avais soif de revanche. Avec Mariano, on avait mis une tactique en place. On s’était dit qu’on allait accélérer la cadence à partir du milieu du deuxième round parce qu’il avait tendance à fléchir physiquement à la mi-combat. Et pile poil à la moitié du deuxième round, il y a le choc de tête. Le combat s’arrête. On pensait qu’ils allaient me donner la victoire parce que le gars était bien ouvert et que ce n’était pas vraiment ma faute : on s’était cognés mutuellement. Moi aussi j’étais un peu ouvert. Le premier round était disputé mais je ne me voyais pas le perdre. Ils lui donnent la victoire en se basant sur ce round. C’était frustrant mais j’ai eu deux secondes de réflexion et j’ai pensé à mes camarades qui avaient encore des combats et qui étaient en lice pour une médaille. Donc je suis resté tranquille, respectueux malgré la frustration que j’ai pu ressentir à ce moment. J’ai pensé à l’équipe plus qu’à moi. J’ai encouragé les autres, je ne suis pas sorti faire la fête, je suis resté dans la compétition jusqu’à la fin et après on a tous pu se faire plaisir. Au final, je suis très content de cette médaille. Elle vaut de l’or. Je ne suis pas champion olympique mais j’en ai la reconnaissance, dont celle de Floyd Mayweather qui était au bord du ring à Rio et qui a voulu me signer dans la foulée. Aujourd’hui, j’ai énormément de monde qui me suit, j’ai les médias derrière moi. C’est une vraie satisfaction.
– Précédemment toujours, John Dovi nous expliquait qu’à son époque, c’était vraiment « bancal » de passer professionnel en France. Avez-vous eu l’impression d’avoir bénéficié d’un contexte plus favorable ?
Bien sûr. Après les Jeux tous les médias se sont intéressés à la boxe. Il y a vraiment un engouement autour de la boxe et des boxeurs. On est un peu sortis des stéréotypes et des idées reçues qu’on pouvait avoir sur les boxeurs : des mecs un peu cinglés qui aiment prendre des coups. Dans l’équipe de Rio, il y avait un ingénieur, un mec de Sciences Po, un chef d’entreprise… C’était solide. Et puis on a été le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France. Les télés se sont intéressées à nous, les promoteurs ont répondu présent. On a tous eu beaucoup de propositions en France et à l’étranger. Aujourd’hui, le contexte est donc bien meilleur. À l’époque de John et quasiment jusqu’à la dernière olympiade, c’était compliqué pour les boxeurs. D’ailleurs, ils ont presque tous arrêté.
– Quand on passe pro et qu’on commence à construire une carrière, la problématique du choix des adversaires est essentielle. Avez-vous votre mot à dire dans le choix du casting ? Combien faut-il de combats pour être prêt à viser un titre mondial ?
On a évidemment toujours notre mot à dire car on est les premiers concernés. C’est nous qui montons sur le ring. Après, j’ai une équipe, un promoteur et un coach qui me connaît très bien. S’il me donne le feu vert pour tel ou tel boxeur, je le prends sans hésiter. J’ai mon mot à dire mais j’ai suffisamment confiance en Virgil pour accepter les adversaires qu’il me propose. Il faut être intelligent, bien sûr. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Une carrière, cela se monte surtout à l’époque du sport business. Il faut faire attention et bien gérer, mais je ne refuse personne. Je ne suis pas là pour tricher. Je suis un compétiteur. Si je m’entraîne très dur, ce n’est pas pour prendre des mecs et les coucher au premier round. Je veux prendre des boxeurs qui vont me faire travailler et progresser, pas des mecs qui sont là pour s’allonger. Aujourd’hui, le Covid-19 a tout retardé, mais je pense pouvoir viser une chance mondiale dans peu de temps. Je suis 24e mondial sur boxrec. À partir du moment où tu es dans le top 15 mondial, le champion peut te prendre sur dérogation. Ça peut aller très vite. Avec la boxe, ça peut être n’importe quand, cela dépend de l’environnement, de la conjoncture, des opportunités, etc. Mais avant ça, j’ai encore besoin de faire quelques combats. Avec quatre combats de plus, quinze combats en tout, je pense que je serai assez aguerri.
– Et comment fait-on pour bien s’entourer, que ce soit au niveau de l’encadrement médical ou mental par exemple ? Vous écoutez les conseils d’autres sportifs ?
Quand tu passes professionnel, tu as tout à refaire. À l’INSEP tu es « assisté », tu es entouré, tu as tout le monde autour de toi, les médecins, etc. J’ai gardé certaines personnes de l’INSEP comme le kiné Lorenzo Martinez qui travaille aussi pour l’AS Monaco. Je bosse avec lui quand je suis en France. Je suis aussi suivi par un médecin de l’INSEP qui me connaît bien. Et vu que je passe beaucoup de temps aux États-Unis, j’ai un préparateur physique, un kiné et mon coach là-bas. Le préparateur physique a l’habitude de bosser avec Virgil Hunter. La préparation mentale est aussi très importante. La boxe, c’est de la préparation mentale au quotidien, tous les jours à la salle. En camp d’entraînement, tu rentres dans ta bulle, tu penses à ton adversaire, tu ne vois que lui. Maintenant, je considère qu’un Virgil Hunter est également un préparateur mental. Il sait trouver les mots justes.
– Vous êtes très vite parti à l’étranger pour vous entraîner, chez Virgil Hunter aux États-Unis, tout en continuant à vous entraîner avec Ali Oubaali à Bagnolet lorsque vous êtes en France. Qu’est-ce que vous êtes allé chercher chez Virgil Hunter ? Et comment est-ce que vous faîtes cohabiter vos différents entraîneurs ? N’y a-t-il pas un risque qu’ils se marchent sur les pieds, notamment le jour du combat ?
Mon coach numéro 1, c’est Virgil Hunter donc c’est lui qui est dans le coin, même quand il y a d’autres coachs américains qui sont présents. Avec Ali, on n’est plus sur de l’entraînement. Ils sont complémentaires parce qu’Ali m’apporte une touche mi-distance, la guerre, le travail au corps, le côté finisseur. Et Virgil est surtout sur le QI boxe, la boxe intelligente, l’élégance, comment surprendre et gêner l’adversaire. J’essaye de concilier les deux parce qu’il y a des combats que tu vas gagner avec la tête et d’autres où il faudra y aller avec autre chose. Au-delà de ça, avec Ali on est dans une relation presque familiale. Ça fait longtemps qu’on travaille ensemble. Et il est bon en préparation mentale. Il te fait comprendre pas mal de choses, il te fait grandir. Après, pour revenir à Virgil Hunter, j’ai une chance inouïe de bosser avec un mec comme lui. C’est un grand professionnel, sans doute le meilleur coach du monde.
– On dit souvent qu’un entraîneur est une « éponge », finalement, vous êtes dans cette position également en allant « piocher » ce qui vous intéresse ici et là ?
Oui, d’autant plus que j’arrive à bien bosser avec les deux. Même s’ils ne sont pas ensemble dans le coin, j’arrive à assimiler ce que chacun me propose. Pour moi, un boxeur doit savoir s’adapter, même par rapport à ses méthodes d’entraînement. Pendant le confinement, par exemple, on a dû s’entraîner sans sortir ni monter sur le ring. Ce n’est pas grave, je suis chez moi, je m’adapte, j’ai des petites bouteilles d’eau, je fais des exercices… Pareil quand tu es sur le ring, tu dois avoir un plan A, un plan B, un plan C, tu dois t’adapter à la boxe de l’adversaire.
– Depuis que vous êtes passé pro, vous avez fait 11 combats : c’est-à-dire 3 ou 4 combats par an. Avez-vous besoin de boxer régulièrement et de rester actif pour continuer à progresser ?
J’ai toujours été comme ça. J’ai besoin de boxer régulièrement pour progresser. Il y a d’autres boxeurs qui peuvent se contenter de mettre les gants. Pas moi. Plus je boxe, plus mon niveau s’élève. J’ai besoin de boxer, d’enchainer les combats pour toquer à la porte d’une chance mondiale et affronter les trois, quatre meilleurs très rapidement. Je n’attends que ça.
– Comment avez-vous géré la période du confinement lié au coronavirus, justement ? Dans le monde de la Formule 1, Charles Leclerc expliquait que cela allait être très difficile pour les pilotes au niveau des muscles du cou notamment après la reprise. Quels aspects seront difficiles de votre côté ?
C’est surtout la notion de coup d’œil, les sensations sur le ring, le temps de réaction. Ça se perd vite mais en travaillant dur pendant quelques séances ça revient. Quand tu es tout seul, tu ne fais que de la préparation physique, tu cours et tu fais du vélo, du shadow… Ce n’est pas la même chose qu’avec un adversaire ou un coach en face de toi, qui te met des vrais coups que tu dois esquiver. Il y a quand même des points positifs : tu travailles des choses que tu ne travaillais pas forcément avant. Cela te permet aussi de grandir mentalement parce que tu te redonnes tes objectifs, tu te dis que tu as envie de taper les meilleurs le plus vite possible.
– Beaucoup de boxeurs disent que le plus dur c’est le travail à l’entraînement et que le combat est quasiment une récompense. C’est aussi votre avis ?
Oui et non. C’est vrai qu’on s’entraîne tellement dur que le combat devient une sorte de cerise sur le gâteau, une libération. On a été enfermés, on a travaillé jour et nuit pour une date… Mais il ne faut pas oublier qu’il y a des combats qui sont beaucoup plus difficiles que d’autres, des combats où tu peux prendre des coups très durs.
– En boxe, votre corps est votre capital. Chaque combat vous permet de le développer en gagnant de l’expérience tout en le mettant en danger. Comment est-ce que vous gérez cette problématique et l’appréhension qu’il y a à mettre en jeu votre intégrité physique ?
Il faut dire ce qui est, on n’est pas fait pour prendre des coups, les mains ne sont pas faites pour taper comme ça. Cela dit, on fait un sport qui est encadré par des règles et un arbitre. Il y a eu quelques décès, malheureusement, et désormais les arbitres font de plus en plus attention au boxeur. Lorsqu’il est mis en difficulté, ils arrêtent beaucoup plus rapidement le combat. On est mieux protégés mais faut être fort mentalement pour se dire qu’on va monter sur le ring et prendre des coups. Après, on est conditionnés, on se prépare pour ça. On s’entraîne sérieusement. On sait ce qui va se passer. On travaille beaucoup la défense. On met toutes les chances de notre côté pour éviter de prendre de mauvais coups. On fait en sorte de prendre le moins de coups possible.
– Après son deuxième combat perdu contre Tyson Fury, Deontay Wilder a licencié son entraîneur Mark Breland en l’accusant d’avoir jeté l’éponge. Cela pose la question du rôle du coach. Sa première mission n’est-elle pas de protéger son boxeur ? Est-ce vous en parlez avec vos entraîneurs ?
C’est clair que le coach doit protéger son boxeur. Ce serait vraiment dommage pour moi d’avoir un entraîneur qui attende que ce soit l’arbitre qui arrête le combat. Je travaille avec des gens qui ont beaucoup d’expérience, qui savent ce qu’ils font et qui sont capables de te prévenir : « Écoute, si ça continue comme ça, on va arrêter le combat ». Ils ont suffisamment de métier pour savoir arrêter un combat à temps. Après, jeter l’éponge, c’est toujours une décision compliquée à prendre. Chaque boxeur est différent : tu peux être en difficulté et renverser la vapeur. L’entraîneur doit sentir ce genre de choses.
– Vous avez la réputation d’être très gentil dans la vie de tous les jours. Du coup, où est-ce que vous allez chercher l’agressivité nécessaire pour être bon sur le ring ? Avez-vous un accompagnement au niveau « mental » spécifique ?
C’est vrai. Je dirais même qu’il me manque encore un peu d’agressivité. Je fais un travail sur moi-même parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu’un de tranquille, je ne suis pas un mec à problèmes. C’est ma personnalité mais la boxe est un sport de caractère. Il faut aller chercher le mec en face, c’est comme ça. Je fais un gros travail de préparation mentale à l’entraînement pour me conditionner, pour me forcer à m’imposer et à enchaîner à chaque fois que je mets les gants. Après, ça reste un sport qui me donne du plaisir. Le jour où ce plaisir aura disparu, il faudra arrêter. J’en parle beaucoup avec Virgil Hunter. Il me dit qu’il faut que j’apprenne à être un peu plus agressif parce que parfois il y a des combats où il faudra aller chercher les mecs. Il me pousse à la leçon, au sac, en mise de gants. Pour devenir champion du monde, tu es obligé d’être agressif, tu dois être fort mentalement et aller chercher cette agressivité pour t’imposer. C’est indispensable.
– On dit souvent qu’à un moment donné, l’athlète de haut niveau doit choisir entre le sport et les études. De votre côté, vous avez refusé de faire ce choix en suivant un DUT Techniques de commercialisation, une Licence de gestion et management du sport et un Master en droit du sport à La Sorbonne. Qu’est-ce que cela vous apporte au quotidien pour votre carrière et peut-être aussi et surtout pour votre après-carrière ?
Une certaine stabilité, un équilibre. J’ai remarqué que quand j’étais trop focus sur le sport, je n’avais pas forcément les meilleurs résultats sportifs. Pareil pour les cours. Mais quand j’ai su trouver le bon équilibre entre les deux, cela a tout de suite fait la différence et j’ai pu obtenir de bons résultats sportifs et scolaires. Cela m’aide dans la vie de tous les jours. Mine de rien, les médias vont t’interroger parce que tu t’exprimes bien. Aujourd’hui, on est ambassadeurs de notre sport et du sport français donc on se doit de montrer une bonne image. En plus, en boxe tout peut aller très vite. Un coup et tout peut s’arrêter, donc c’est mieux d’avoir un bagage au cas où pour l’après-carrière.
– C’est un message important pour les jeunes qui veulent se lancer selon vous : faire du sport, mais aussi chercher à pousser le cursus scolaire au maximum ? Précédemment, Marc Lièvremont nous expliquait que pour lui, il s’agissait d’un élément élémentaire pour un développement « cohérent » des joueurs de rugby.
Je dis souvent qu’un bon boxeur est un boxeur intelligent. Être intelligent, cela ne veut pas forcément dire aller à l’école, mais aimer s’instruire et travailler. Au-delà de ça, c’est important que les plus jeunes soient conscients qu’en boxe : une carrière peut s’arrêter à n’importe quel moment. D’où l’importance de pouvoir compter sur une roue de secours, un bagage avec plein d’outils dedans dont tu peux te servir en cas de pépin.
– Dans une interview à Dans le Ring, vous disiez suivre une formation sur la diététique du sport. De l’extérieur, on a la sensation que vous avez la volonté de maitriser un maximum de paramètres : à partir d’un certain niveau, à quoi se jouent les différences entre un bon boxeur et un très bon boxeur ?
Je suis à la recherche des gains marginaux. C’est la somme des détails qui fait la différence. Arrivé à un stade, tu peux être super bien physiquement, mais ton adversaire le sera aussi. Vous aurez eu les mêmes conditions de travail, une préparation similaire et ce seront tous les petits détails auxquels tu auras prêté attention ou pas pendant ton camp d’entraînement qui changeront tout sur le ring : ce que tu auras mangé en plus, l’heure de sommeil en moins, etc. Il n’y a pas de secret : le très haut niveau, c’est du travail, de la rigueur et des sacrifices.
– Dans une autre interview, sur RMC Sport, vous déclariez qu’Anthony Joshua avait peut-être perdu son premier combat contre Andy Ruiz parce qu’il avait consacré trop de temps aux médias. Comment faites-vous pour éviter que les sollicitations médiatiques, qui sont de plus en plus importantes, ne vous pompent toute votre énergie ?
C’est vrai qu’il y a pas mal de sollicitations mais on essaye de les caser à des moments stratégiques. On travaille avec un calendrier pour voir quand c’est plus facile pour moi, sportivement, de parler aux médias. Virgil Hunter insiste beaucoup là-dessus : on ne s’en rend pas compte, mais répondre aux questions pompe énormément d’énergie. Et j’ai besoin de cette énergie sur le ring ! Quand le combat approche, j’essaye donc de faire le minimum de médias ou de me faire envoyer les questions à l’avance pour que je puisse répondre tranquillement ou par l’intermédiaire de mes équipes.
– Aux États-Unis, on attend des boxeurs qu’ils soient ambitieux, on les encourage à clamer haut et fort leurs ambitions. Ressentez-vous qu’en France, c’est culturellement plus difficile d’affirmer ses ambitions ?
C’est très différent et on doit s’adapter. Aux États-Unis, ils sont obsédés par la performance. Tu peux voir un boxeur avec un seul combat qui dit qu’il veut être le numéro 1 et qui défie le champion du monde. Les mecs sont super ambitieux. C’est une autre mentalité. En France, on n’aime pas trop ça. On n’aime pas le trash talking. C’est compliqué parce que pour devenir un champion tu dois développer ton égo. Sauf qu’ici, si tu dis que tu veux boxer untel ou untel, on peut te tomber dessus en disant que tu n’as pas encore fait tes preuves. Aujourd’hui, on boxe beaucoup plus en France qu’à l’étranger donc on s’adapte au public français et puis voilà. Et quand on boxe aux États-Unis, on s’adapte aussi et on fait le show. Ce qui est sûr, c’est qu’on doit continuer à organiser de beaux galas en France pour que l’intérêt pour la boxe ne retombe pas, et que le public grandisse et évolue avec nous.
– Dernière question : depuis quelques années, notamment avec la carrière de Floyd Mayweather, le monde de la boxe est de plus en plus obsédé par l’invincibilité, par le « 0 » sur le palmarès. Comment est-ce que vous vivez ça : cet aspect « recherche de l’invincibilité », peut-être même parfois à outrance ?
Aujourd’hui, toute la société est construite sur une vision élitiste. Même les marques recherchent ça : on veut les meilleurs. C’est comme ça. En boxe, le meilleur c’est celui qui n’a jamais perdu ou presque. C’est un sport ingrat où l’on ne te pardonne rien. À la rigueur, on peut te passer une défaite mais en championnat du monde et tu vas avoir intérêt à faire de gros résultats dans la foulée. Après, en tant que boxeur, tu te prépares pour gagner, pas pour perdre. Tu te donnes tous les moyens pour l’emporter, même si personne n’est à l’abri de quoique ce soit. Ma mentalité, c’est la gagne. Je m’entraîne très dur, parfois j’ai envie de pleurer à l’entraînement, je donne tout ce que j’ai, tout ce que je peux. L’essentiel, c’est de ne pas avoir de regrets.
NZ