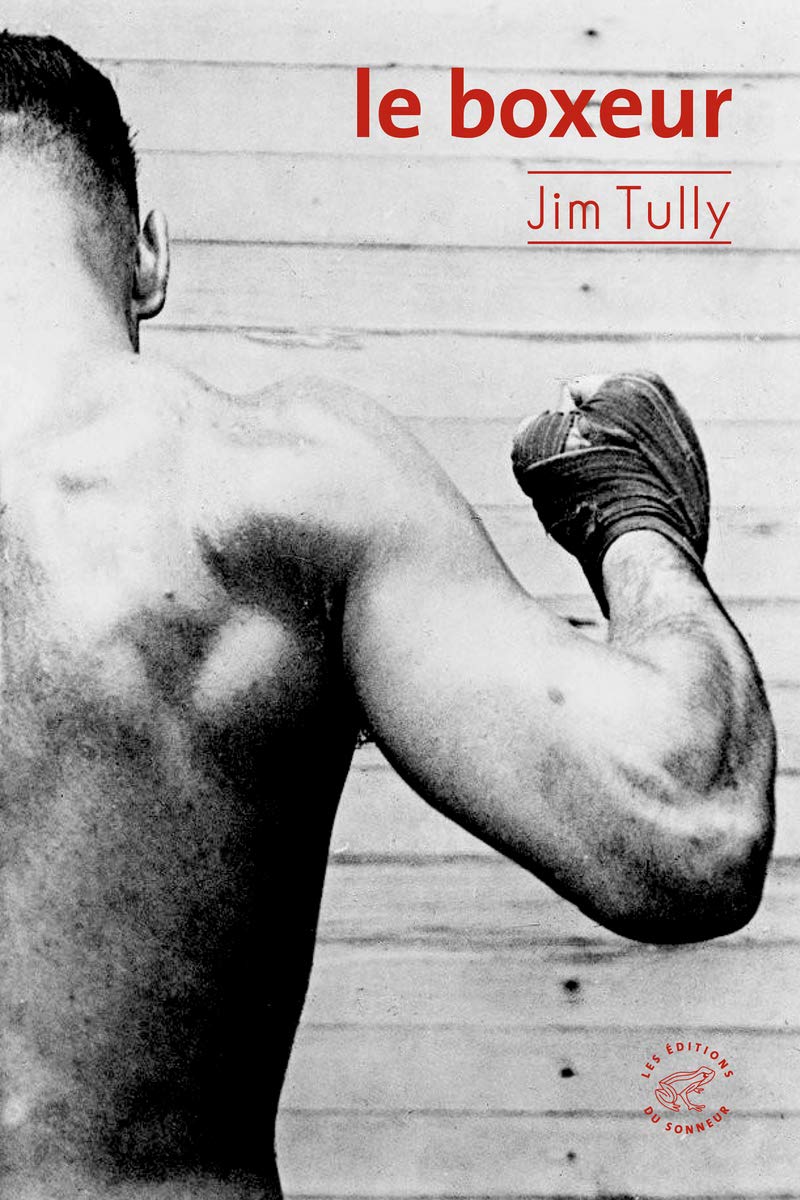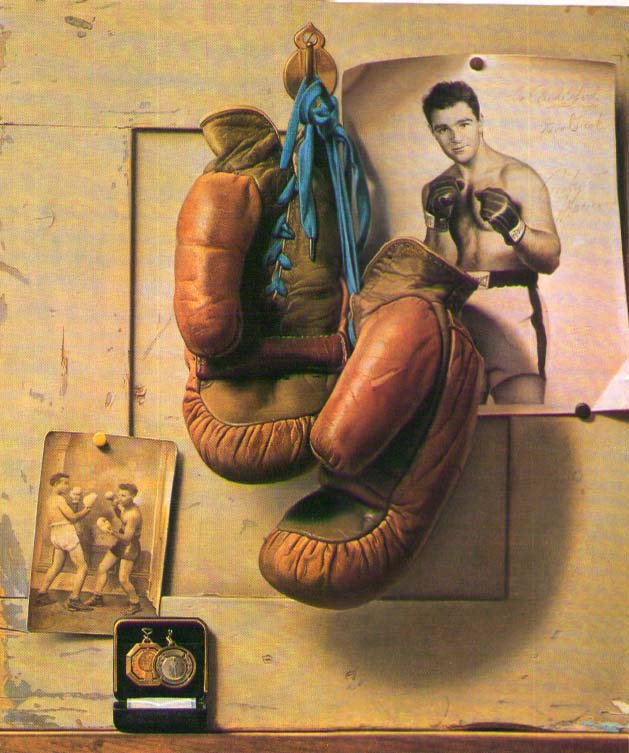Le Boxeur. The Bruiser en VO. L’auteur sait de quoi il parle.
Avant de devenir une célébrité nationale dans les années 1920-1930, connu et reconnu pour ses talents de romancier, journaliste et son amitié avec Charlie Chaplin, Jim Tully a bien roulé sa bosse sur la route et les rings.
Il est né en 1886 à St Mary dans l’Ohio. Son père est terrassier, et sa mère meurt quand il a six ans. Tully passe son enfance à l’orphelinat – puis, à douze ans, son père le place comme ouvrier agricole chez un fermier brutal.
A treize ans, Tully s’enfuit et retourne à St Mary, où les vagabonds lui racontent leurs voyages. A quatorze ans, il devient un gamin de la route et du rail, une sorte d’apprenti vagabond. Le reste de son adolescence, il la passe sautant de train en train en compagnie de hobos, prostituées et forains.
En 1906, à vingt ans, Tully devient boxeur. Un boxeur sans aucun entrainement, mais qui n’a peur de rien. Le genre à accepter d’en prendre deux pour en mettre une. Il remporte quelques succès mais il réalise vite qu’il vaut mieux ne pas s’éterniser sur le ring. Ce qui ne l’empêche pas d’écrire, quelques années plus tard, un livre remarquable sur la boxe.
Le héros, Shane Rory, est un jeune vagabond dans l’Amérique du début du XXe siècle qui risque sa vie entre les cordes pour quelques dollars. Un personnage attachant inspiré par la propre expérience de l’auteur mais aussi par le parcours d’anciens champions. Le bouquin est dédié à « un autre gamin de la route, Jack Dempsey », qu’on peut également admirer de dos sur la couverture de l’édition française (bravo aux éditions du Sonneur qui ont entrepris de proposer toute l’oeuvre du bonhomme au public français), et ce n’est pas pour rien. On reconnaît ici ou là des clins d’œil au « Manassa Mauler » qui, avant de devenir un champion, a lui aussi connu la misère et les trains de marchandises.
Avec sa plume tranchante, typique du roman noir américain, Jim Tully trace le portrait d’un monde fait de poussière, de managers véreux, de boxeurs sonnés, de petites gares de campagne, de petites garces de compagnes et de durs à cuire.
Dès les premières pages, Shane Rory, hobo de son état, croise la route d’un noir qui comme Jack Johnson s’est sorti sans trop de dommages d’une bataille royale, ces combats opposant plusieurs adversaires les yeux bandés sur le ring jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.
Beaucoup d’appelés, peu d’élus. Jim Tully sait de quoi il parle : il a vu des boxeurs mourir sur le ring. Il en a vu devenir aveugle. Qu’est-ce qui distingue le champion du loser ? Le cran ? La chance ? Le punch ? Tully tourne autour du pot mais peut-être que les mots ne suffisent pas.
Comment un boxeur arrive tout en haut ? avait-il demandé à Smith.
– Il doit avoir tout pour lui, et la chance en plus, avait répliqué l’ancien.
—
Faut plus que du cran pour devenir un champion, Sully, le charria le gérant du club. Beaucoup d’appelés, peu d’élus, nous dit la Bible.
—
Y a pas beaucoup de différence entre un crack et un second couteau… Bien souvent, c’est aussi dur de battre l’un que l’autre.
—
– C’est l’dernier pas qui compte quand on grimpe une montagne, et Shane l’a en lui, ce dernier pas.
– S’il trébuche pas, avait plaisanté le journaliste.
– Il trébuchera pas. Y a ceux qui peuvent aller jusqu’à un certain point, et y a ceux qui vont un pas plus loin. Shane est d’ceux-là.
Les mots sont parfois maladroits à dire une expérience aussi physique que la boxe. Mais Tully a plus d’une corde à son arc :
Maley balance un tas de coups, mais il cogne pas assez fort pour casser un œuf de Pâques.
—
Un insecte vola entre les boxeurs. Il se posa sur le gant de Shane et fut écrasé sur le front de Sully.
Ces réjouissances ne sont pas de trop pour contrebalancer le fond du propos, plutôt sombre. Même si l’accumulation des coups lui fait parfois perdre momentanément ses esprits, Shane Rory a une conscience aiguë de la réalité de son métier : on risque sa vie à la gagner. Et les portraits touchants de plusieurs anciens boxeurs sonnés sont autant de piqûres de rappel. Shane Rory n’a qu’une crainte : « se faire ratatiner la cervelle comme ce pauvre Jerry », un collègue qui finit chez les fous. De fait, la visite qu’il lui rend à l’asile, une visite qu’il dit ne plus pouvoir se sortir de la tête, le marque au fer rouge et conditionne la suite de sa carrière.
Quand Tully écrit Le Boxeur, Joyce Carol Oates n’est pas encore née. Il faudra attendre cinquante ans avant qu’elle publie son fameux De la Boxe et popularise l’idée qu’on ne joue pas à la boxe. Les personnages de Tully donnent pourtant l’impression de jouer à un jeu dangereux. Du genre où l’on perd même quand on gagne.
Tim avait très vite su qu’un boxeur qui traînait la patte ou qui trébuchait n’était pas loin de sucrer les fraises, que l’ébranlement répété de son cerveau n’allait pas tarder à lui jouer des tours. Il avait observé des puncheurs légers se transformer brusquement en cogneurs mortels. Quand leur système nerveux devenait insensible à la douleur, ils pouvaient infliger plus de dommages. Il avait affronté plusieurs types qui avaient perdu la boule. Au bout de quelques années, leur air insouciant avait laissé place à une expression vide. Leur tête était inclinée sur un côté, un rictus grimaçant avait remplacé leur sourire. Ils parlaient en charabia. Leur corps se balançait comme un pendule. Puis la surdité survenait, souvent suivie par la cécité.
Ils n’accusaient personne et ne se plaignaient pas. C’était « le jeu ». Ils auraient pu arrêter à n’importe quel moment. Mais ils n’en avaient rien fait. Au-delà de l’attrait de l’argent, ils avaient quitté la vallée de l’ennui par fascination pour quelque chose qui leur rendait impossible le retour à une existence monotone.
Et la tendresse, bordel ? Comptez pas sur les femmes pour panser les plaies de ces vétérans engagés sur la pente savonneuse. Tully se fait un plaisir de distribuer quelques coups sous la ceinture.
J’ai encore jamais vu un crac s’encombrer d’une môme sans commencer à perdre. Quand un boxeur s’met à la colle avec une gonzesse, c’est comme s’il acceptait d’avoir le manager de son adversaire dans son coin, comme s’il remplissait les poumons de chloroforme. Puis, elle le laisse tomber dès qu’il arrête de gagner.
—
Les femmes qui épousent des pugilistes – Dieu bénisse mon âme en lambeaux – sont souvent plus cruelles que leurs managers…
Celui qu’on a appelé « le chaînon manquant entre Jack London et Jack Kerouac » annonce d’autres œuvres signées par d’anciens boxeurs comme Fat City de Leonard Gardner – dont le personnage principal s’appelle Tully – et la Brûlure des cordes de F. X. Toole.
A froid ou à chaud, tant que vous n’aurez pas mis les pieds sur un ring, vous aurez pas idée d’la dureté et d’la vitesse d’un coup de poing, pas plus que d’la valeur d’un gars capable de descendre un boxeur comme Flynn, rétorqua le manager.
Au bout du compte, avec un train d’avance, Tully pose une question essentielle : comment vivre de ses poings quand on sait que tout peut s’arrêter en une seconde ?
Le Boxeur, éditions du Sonneur, 2021
NZ